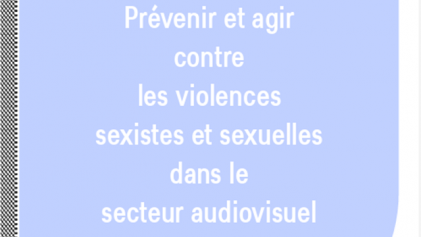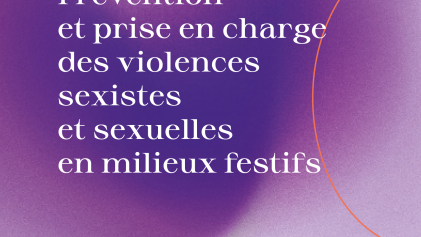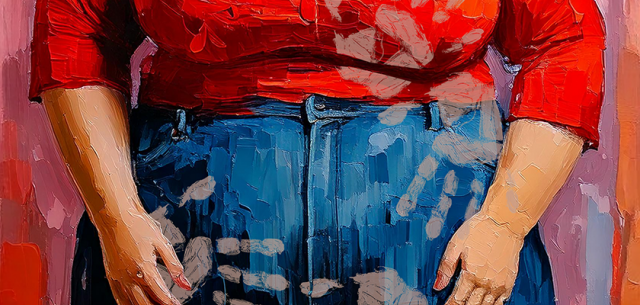Violence sexuelle
Les violences sexuelles constituent une infraction pénale. Quel que soit le genre de la victime, la grande majorité des violences sexuelles sont exercées par des hommes de tout âge, classe sociale et origine. Les violences sexuelles peuvent prendre 4 formes :
- l’atteinte à l’intégrité sexuelle
- le viol
- le voyeurisme
- la diffusion non consentie de contenu à caractère sexuel
On peut donc être victime de violence sexuelle même s’il n’y a pas eu de contact physique avec l’agresseur.
De très nombreuses femmes subissent des violences sexuelles. Toutefois, des hommes peuvent également subir des violences sexuelles. Peu importe leur âge, leur classe sociale, leur origine. Ces violences peuvent entraîner des conséquences durables.
Même longtemps après, il est donc toujours temps d’agir. Et de chercher un soutien.

Une violence sexuelle ? Un acte sexuel non consenti
Si on s’interroge sur le fait d’avoir été victime ou pas de violences sexuelles, il faut d’abord bien se rappeler que tout acte sexuel doit être consenti. Sinon ? C’est de la violence sexuelle ! Et c’est seulement quand les deux personnes sont d’accord de partager une intimité sexuelle que l’on peut parler de consentement .
Ne pas résister ne signifie pas être d’accord
Une personne ne résiste pas ? Ça ne veut pas dire nécessairement qu’elle est d’accord de partager de la sexualité ! Parfois, le corps peut être comme paralysé, on n’arrive pas à articuler un « non » à voix haute. Mais cela ne veut pas dire qu’il y a un accord .
Que faire face à une victime de violence sexuelle ?
- Appeler le 112 s’il y a urgence médicale ou danger immédiat.
- Inviter la victime à se rendre dans un Centre de Prise en charge des Violences Sexuelles, appelé CPVS, juste après les faits et idéalement dans les 78 heures. Cette rapidité permet d’avoir la prise en charge la plus efficace possible. C’est essentiel pour les risques d‘infection sexuelle, de grossesse non désirée ou pour la prévention d’un trouble de stress post-traumatique.
Les CPVS sont ouverts 24 heures/24 et 7 jours/7 et leurs services sont gratuits.
Que proposent les CPVS ?
- Un accompagnement par des personnes professionnelles formées
- Une prise en charge médicale
- Une prise en charge médico-légale avec relevé de preuves ADN
- Un appui psychologique
- Un soutien policier en cas de dépôt de plainte
Bon à savoir
- Mieux vaut éviter de brusquer la victime et lui laisser le temps de prendre elle-même la décision de s’y rendre.
- De nombreuses victimes d’agressions sexuelles ou de viol n’en parlent que plusieurs années après.
- Les CPVS offrent une prise en charge adaptée aux victimes mineures
Dans le cadre d’une réorientation, il est possible d’encourager la victime à s’adresser à :
- des associations qui proposent un accompagnement spécialisé pour toute personne qui a subi des violences sexuelles même si les faits ont été perpétrés il y a plus d’un mois, y compris dans l’enfance
- des associations spécialisées dans l’accompagnement des enfants
- des structures qui offrent des conseils juridiques.
Violences sexuelles. Où demander de l’aide ?
- Au 0800 98 100. C’est la ligne téléphonique gratuite et anonyme de « Violences sexuelles », un premier pas que l’on peut aussi faire par écrit via le tchat disponible le lundi et le vendredi de 17 à 21 heures et le mercredi de 14 à 18 heures.
- Dans un Centre de Planning familial à proximité.
- Il est aussi possible d’en parler à une personne de confiance, à quelqu’un de la famille, à son ou sa médecin…
- Des services d’aide aux victimes proposent gratuitement un suivi psychologique et une aide sociale. L’aide proposée y est généraliste. Elle oriente et soutient la victime dans ses démarches.
Aides spécifiques pour les moins de 18 ans
• Le tchat “Maintenant j’en parle” répond à toutes les questions des personnes mineures dans l’anonymat.
• La ligne Écoute Enfants au 103.
Comment soutenir une victime de violences sexuelles ?
C’est une évidence : les violences sexuelles peuvent entrainer des conséquences durables sur les victimes. Et pour l’entourage, faire face à son impuissance et à la frustration de voir un être cher en détresse, c’est aussi une épreuve. Mais tout proche, tout témoin peut soutenir la victime. C’est un rôle capital. Voilà pourquoi des services spécialisés sont là pour aider et conseiller les proches et les témoins.
Le rôle capital des proches et témoins pour une victime de violences sexuelles
De nombreuses victimes ne vont pas rechercher de soutien. Pourquoi ? Parce qu’elles ont peur, se sentent coupables, honteuses ou encore à cause de leur état de santé suite au traumatisme. C’est pour ça que le rôle des proches est si important.
Voici quelques éléments à connaitre pour avoir la bonne réaction quand une personne de l’entourage confie une agression sexuelle :
- Croire
La première chose à faire est de s’assurer que la victime se sent en sécurité. Il est important de lui dire que vous la croyez et que ce qui s’est passé est inacceptable. - Écouter, sans juger
Fournir une écoute active et attentive, sans jugement. Il est important de ne pas forcer la victime à parler plus que ce qu’elle n’a décidé. Il est également déconseillé de faire quoi que ce soit à sa place, de prendre une initiative qu’elle ne souhaite pas.
Respecter son rythme et ses besoins
Il faut respecter son rythme et ses besoins car elle doit pouvoir retrouver le contrôle de ses choix et de sa vie. - Demander de quoi elle a besoin
Ensuite ? Voir dans quelle mesure il est possible de répondre à ce besoin. Ou aider la victime à trouver les personnes compétentes et formées pour répondre à ses demandes. - Proposer des services
On peut proposer de rendre certains services : accompagner la victime ou aller récupérer ses affaires dans un lieu où elle ne souhaite pas se rendre, l’accompagner ou faire ses courses, faire son ménage, faire des recherches de services, proposer de prendre des notes lors de ses entretiens avec des services professionnels, etc. - Convenir d’un code
Quand on accompagne une victime dans un endroit, on peut convenir d’un code. Dès qu’elle active ce code, on sait qu’elle est mal à l’aise en public et qu’elle souhaite de l’aide pour quitter le lieu.
Bon à savoir
Les conséquences des violences sexuelles peuvent durer des années. Il est important de laisser à la victime l’espace pour en parler quand elle en aura besoin.
Mais attention ! Proches et témoins doivent aussi être à l’écoute de leurs propres besoins et poser leurs limites.
Que faire si la victime ne s’est pas confiée mais que tout porte à croire qu’il y a ou il y a eu des violences ?
Ce n’est pas facile de réagir lorsqu’on est témoin de violences ou qu’on soupçonne des violences.
On peut éprouver un sentiment d’impuissance, on n’ose pas intervenir.
On peut aussi avoir peur des conséquences pour la personne ou pour soi-même.
Des services spécialisées sont disponibles pour les proches et les personnes témoins de violences.
Ils sont là pour écouter, répondre aux questions, conseiller.
La personne ne souhaite pas se confier ?
C’est une décision à respecter. On peut l’assurer d’être là quand elle sera prête.

Quelles peuvent être les conséquences des violences sexuelles ?
Les violences sexuelles peuvent provoquer des traumatismes. Elles peuvent avoir des conséquences à long terme sur la santé mentale et physique, la vie sociale, sentimentale et économique de la victime.
Il est donc important de la croire, de lui offrir une écoute bienveillante et de ne pas la juger. C’est à elle de reprendre le contrôle de sa vie. À son rythme à elle.

Est-ce qu’on ne devrait pas voir des traces physiques d’une violence sexuelle ?
Pas du tout ! Contrairement à une idée reçue, la plupart du temps, les traces des violences sexuelles ne sont pas visibles à l’œil nu. Seules 10 % des victimes présentent des blessures ou marques physiques, graves ou non. Par contre, des traces d’ADN de l’agresseur peuvent être relevées jusqu’à 78 heures après l’agression. Mieux vaut donc conseiller à la victime de se rendre dans un Centre de Prise en charge des Violences Sexuelles (CPVS).
Est-ce qu’on peut être violée par une personne proche ?
Oui. Contrairement à des stéréotypes répandus, la grande majorité des agressions sexuelles sont commises par une personne connue de la victime.
C’est le cas de 89 % des victimes qui appellent la ligne d’écoute de SOS viol . Les auteurs sont très majoritairement des hommes. Le Haut Conseil de l’Égalité entre les Hommes et les Femmes en France (HEC) estime que les hommes sont auteurs de 91 % des violences sexistes . Les violeurs sont des personnes “comme tout le monde”. Ils sont issus de tous les milieux sociaux. Voisin, ami, colocataire, parent, entraineur sportif, connaissance, collègue, la plupart du temps le violeur est une personne que la victime connait et fréquente.
Les victimes et auteurs de violences sexuelles ont souvent un entourage et un environnement commun, ce qui rend difficile la prise de parole par les victimes. Elles ont peur de ne pas être crues, elles ont peur du rejet, elles se sentent coupables, honteuses... Dès qu’une personne n’a pas consenti à avoir une relation sexuelle, c’est un viol.

Les violences sexuelles, est-ce que ça arrive souvent ?
Oui. Les violences sexuelles sont malheureusement largement répandues.
N’importe quelle personne pourrait être victime de violences sexuelles mais les femmes et les filles sont touchées de manière beaucoup plus importante.
Environ 64 % de la population belge âgée de 16 à 69 ans a déjà subi une forme de violence sexuelle, allant du harcèlement sexuel à l'exploitation sexuelle. L’enquête réalisée en 2021 en Belgique indique qu’environ deux femmes sur cinq (19 %) et un homme sur cinq (5 %) ont été victime de viol.
On estime aussi que 2 à 3 enfants par classe subissent ou ont subi des violences sexuelles.
Certains groupes de la population (personnes racisées, en situation de handicap, LGBTQIA+, etc.) sont plus exposés aux violences, dont les violences sexuelles, car ils subissent des discriminations cumulées.
Selon les statistiques des Centres de Prévention des Violences sexuelles, 90% des victimes sont des femmes et 62% d’entre elles connaissent l’auteur des violences sexuelles.

Besoin d'en parler ?
On réagit toutes et tous différemment face à une personne qui se confie à nous ou lorsqu'on est témoin de violences. C’est une question de sensibilité mais c’est aussi fonction du vécu de chaque personne.
Il est normal de ressentir des émotions différentes, comme du malaise, de la colère, de la tristesse, de la peur, de l’impuissance ou encore de l’incompréhension.
Rester à l’écoute de son propre ressenti et veiller à sa santé émotionnelle est essentiel pour pouvoir offrir le meilleur soutien possible à la personne concernée.
Voilà pourquoi des services sont là pour aider et conseiller les proches et les témoins de violences sexuelles.
FAQ
Questions fréquentes
Le site www.noustoutes.org conseille quelques phrases utiles et qui font du bien à entendre pour la victime :
- Je te crois.
- Tu as bien fait de venir me voir.
- Merci de ta confiance.
- Tu as bien fait de m’en parler.
- C’est courageux.
- Tu n’y es pour rien.
- La loi interdit ces violences.
- Je peux t’aider.
La mémoire traumatique est un phénomène psychologique et neurobiologique où des événements particulièrement violents, tels que les violences sexuelles, sont stockés de manière dysfonctionnelle dans le cerveau. Contrairement à une mémoire classique, ces souvenirs ne sont pas intégrés de manière cohérente et restent figés, souvent associés à des émotions intenses comme la peur, la honte, ou la terreur. Lorsqu'un souvenir traumatique est réactivé, la personne peut revivre l'événement comme s'il se produisait à nouveau, avec les mêmes émotions et sensations physiques.
Comment la mémoire traumatique se manifeste-t-elle ?
La mémoire traumatique peut se manifester par des flashbacks, des cauchemars ou des réactions de panique déclenchées par des éléments rappelant l'agression. Ces souvenirs sont souvent fragmentés, désordonnés et peuvent ressurgir de manière inattendue. Ils plongent la personne dans un état de détresse intense. La mémoire traumatique rend difficile la verbalisation et l'intégration des expériences traumatiques, ce qui complique la guérison. Cela nécessite un accompagnement thérapeutique spécialisé pour aider la personne à désensibiliser ces souvenirs et à les intégrer dans son histoire de vie de manière moins douloureuse.
Les données statistiques montrent que les violences sexuelles sont très courantes. On estime que 2 à 3 enfants par classe , filles et garçons, ont subi des violences sexuelles. En Belgique, l’étude de l’Université de Gand montre que 64 % de la population résidant en Belgique, âgée entre 16 et 69 ans, a vécu de la violence sexuelle (81 % de femmes et 48 % d’hommes).
Les violences ont des effets sur le long terme, dans toutes les sphères de la vie de la victime. En France, on estime que les coûts liés à aux violences sexuelles dans l’enfance se chiffrent à 9,7 milliards d’euros. Il s’agit donc d’un problème majeur, tant sociétal que de santé publique.
Vu l’ampleur de cette problématique et le nombre de cas, c’est-à-dire sa prévalence, on pourrait dire que la société en fait encore beaucoup trop peu pour lutter contre les violences sexuelles.
Non. Malgré de nombreuses tentatives de classification et typologie des auteurs d’infraction à caractère sexuel, il n’existe aucun profil type ou unique. Les auteurs peuvent provenir de tous les milieux sociaux, économiques et culturels . Certaines variables structurelles, situationnelles et relatives au modus operandi doivent être prises en considération sans qu’ils puissent expliquer de façon isolée les conduites violentes sexuelles.
Le consentement constitue un élément déterminant de la violence sexuelle. Il est défini et central dans le nouveau Code pénal sexuel (Art 417/5).
Le consentement doit aussi répondre à plusieurs caractéristiques. Il doit être :
- libre : il ne peut pas être obtenu via la menace, la violence, la contrainte, la surprise ou la ruse
- éclairé : la personne doit être en état de consentir, de comprendre à quoi elle va consentir
- énoncé : le silence ne peut pas être interprété comme un oui
- révocable : il peut être retiré à tout moment
Enfin, il ne peut pas être déduit de la simple absence de résistance…
Le consentement, c’est quand on communique clairement qu’on est d’accord d’avoir une relation sexuelle, d’avoir telle ou telle pratique sexuelle, d’ échanger telle photo intime de soi... Cet accord vaut pour un moment précis, une pratique précise. Le consentement peut être retiré à tout moment, même pendant l’acte sexuel. Il est tout à fait normal et OK de changer d’avis. On peut dire oui et puis ne plus avoir envie.
Par contre, déduire qu’il y a consentement simplement parce qu’une personne n’a pas résisté ou n’a pas dit clairement « non », ça on ne peut pas.
Le consentement est impossible si l’acte à caractère sexuel a été commis :
- en profitant de la situation de vulnérabilité de la victime :
- si elle se trouve en situation de peur
- si elle est sous l’influence de l’alcool ou de toute autre substance qui altère la conscience
- si sa situation de handicap ou de maladie altère son libre arbitre
- à la suite d’une menace, de violences physiques ou psychologiques
- lorsque la personne est endormie ou inconsciente.
On ne peut pas déduire qu’une personne consent à un acte sexuel juste parce qu’elle ne dit pas non ou qu’elle ne dit rien du tout. Le consentement sexuel doit rencontrer 5 caractéristiques :
- Il doit être donné librement : pour donner son consentement de manière valable, il faut être dans des conditions qui le permettent. Être saoule ou sous l’emprise de substances ne permet pas de donner son accord librement. Lorsqu’une personne dort ou est inconsciente, elle ne peut pas donner son consentement. Si on est sous la menace ou si on est forcée (chantage ou peur de représailles en cas de refus), il n’y a pas de consentement possible.
Il n’y a jamais de consentement possible pour un ou une mineure de moins de 16 ans ni pour certaines personnes n’ayant pas la capacité mentale de consentir. C’est le cas pour certains niveaux de handicap mental, par exemple. - Il doit être éclairé : cela signifie que le consentement ne vaut que si on sait ce qu’on partage. Si l’un des partenaires ment ou dissimule délibérément certaines intentions, il n’y a pas de consentement. Par exemple, retirer un préservatif de manière dissimulée alors qu’on prévoyait un rapport protégé c’est un viol.
- Il doit être spécifique : consentir à une pratique intime ou sexuelle comme par exemple à des baisers ne veut pas dire que l’on consent automatiquement à d’autres pratiques comme toucher les seins.
- Il doit être réversible : être d’accord un jour n’implique pas qu’on donne son consentement pour toutes les fois suivantes. Même pendant une relation sexuelle, on est libre de s’arrêter à tout moment sans devoir donner aucune justification. Si le ou la partenaire manifeste son mécontentement et tente de faire changer d’avis, le consentement n’est plus donné librement.
- Il doit être clair et enthousiaste : la question est de savoir si une personne dit « oui » ou donne activement son consentement, de diverses manières, verbales ou non. Il est important que le consentement soit exprimé de façon claire avec des paroles, des gestes ou les deux. Le silence et le fait de ne pas résister physiquement ne signifie pas qu’il y a un consentement.
Un doute ? Il est important de s’arrêter et de vérifier auprès de sa ou de son partenaire, par exemple en lui demandant simplement si elle ou il a envie de continuer à partager ces échanges sexuels ou si elle ou il préfère autre chose. Le doute persiste ? Il faut s’arrêter !
Législation
Ce que dit la loi
En Belgique, les violences sexuelles constituent des infractions graves, passibles d’amendes et/ou de peines de prisons
Cela concerne notamment :
- Le viol
- L’inceste
- L’atteinte à l’intégrité sexuelle
- Le voyeurisme
- La diffusion non consentie d’images ou vidéos à caractère sexuel
- Etc.
Qu’est-ce que la notion de consentement sexuel au regard de la loi ?
Le consentement doit être libre, éclairé et réversible.
- La personne doit le donner librement et il ne peut pas être déduit d’une simple absence de résistance : céder n'est pas consentir.
- Le consentement peut être retiré à tout moment avant ou pendant l'acte à caractère sexuel.
- De plus, le consentement à un acte à caractère sexuel spécifique n’implique pas d’emblée le consentement à un autre acte. Par exemple, le stealthing, c’est-à-dire la poursuite d’un rapport sexuel après avoir retiré son préservatif sans le consentement de son ou sa partenaire, constitue bel et bien un viol.
Il n’y a pas de consentement si :
- La personne est dans une situation de vulnérabilité qui altère son libre arbitre et qui est due à :
- Un état de peur,
- L’influence de l’alcool, de drogues ou d’autres substances psychotropes,
- À une maladie ou à une situation de handicap.
- L’acte à caractère sexuel a eu lieu sous la menace, la violence physique ou psychologique, la surprise, la contrainte ou la ruse
- La personne est inconsciente ou endormie
- La relation a eu lieu en raison d’une situation d’autorité (médecin, enseignant, moniteur sportif, etc.)
- Les partenaires sont de la même famille au sens large ou cohabitants sauf s’ils sont tous les deux majeurs et consentants
- L’un des partenaires n’a pas 16 ans sauf à partir de 14 ans si la différence d'âge ne dépasse pas 3 ans.
Consulter le site de la Justice sur les infractions sexuelles Infractions sexuelles | Service public federal Justice (belgium.be)
Consulter le site des Centres de prise en charge des violences sexuelles (CPVS)
Bon à savoir
Pour toute information complémentaire et pour les définitions complètes, il est préférable de consulter le Code pénal belge, et plus spécifiquement les articles 417/5 du nouveau Code pénal.
Le consentement sexuel des personnes mineures
En Belgique, la majorité sexuelle est fixée à 16 ans. Ce qui veut dire que l’âge pour donner son consentement librement est fixé à 16 ans.
- En dessous de 14 ans : une relation sexuelle est toujours considérée comme un viol, qu’il y ait consentement ou non.
- Entre 14 ans et 16 ans : la loi prévoit que toute relation sexuelle d’une personne majeure avec un adolescent ou une adolescente dans cette tranche d’âge sera considérée comme un viol, sauf si l’écart d’âge entre les deux jeunes n’est pas supérieur à trois années et que les jeunes sont consentants
- À partir de 16 ans (majorité sexuelle) : un mineur peut légalement avoir des relations sexuelles, s’il y consent, avec un ou une jeune de 16 ans (ou plus) ou une personne adulte.
L’inceste est toujours interdit
La loi belge interdit l’inceste même si l’enfant ou l’adolescent dit être consentant (article 417/6 du Code pénal).
Il n’y a jamais de consentement valide lorsque :
- L’auteur est un parent ou un allié en ligne directe ascendante, ou un adoptant, ou un parent ou un allié en ligne collatérale jusqu’au troisième degré, ou toute autre personne qui occupe une position similaire au sein de la famille, ou toute personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec le mineur et qui a autorité sur lui
- L’acte est rendu possible par une position d’autorité, de confiance ou d’influence
- L’acte est lié à une situation de prostitution ou de débauche
L’inceste sur mineur·e est imprescriptible : la victime peut porter plainte sans limite de temps.
Contenus à caractère sexuel
Selon l’article 417/49 du Code pénal, la réalisation, la possession et la diffusion d’images ou de vidéos à caractère sexuel impliquant une personne de moins de 16 ans sont interdites, même si la personne est consentante.
Cela inclut :
- Les sextos ou nudes envoyés entre jeunes
- Les enregistrements partagés volontairement à un moment, mais utilisés ensuite sans consentement (revenge porn, diffusion sur les réseaux, etc.)
Ces actes sont considérés comme des infractions pénales.
Bon à savoir
Pour toute information complémentaire et pour les définitions complètes, il est préférable de consulter le Code pénal belge, et plus spécifiquement les articles 417/06 et 133 du nouveau code pénal.
Consulter le site de la Justice sur les infractions sexuelles Infractions sexuelles | Service public federal Justice (belgium.be)
Les infractions de base du Code pénal en matière de violences sexuelles
Le Code pénal belge prévoit différentes infractions et facteurs aggravants en matière de violences sexuelles (loi du 21 mars 2022).
Voici les infractions de base en matière de violences sexuelles.
- Viol : toute pénétration sexuelle sans consentement sur une personne ou à l’aide d’une personne. Cela inclut le viol à distance ou par l’auto-pénétration forcée.
- Atteinte à l’intégrité sexuelle : commettre des actes sexuels sur une personne sans son consentement ou la forcer à avoir des actes sexuels.
- Voyeurisme : observer ou enregistrer une personne dénudée ou ayant une activité sexuelle sans son consentement.
- Diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel : montrer ou partager des images ou vidéos sexuelles d’une personne sans son accord. Cela concerne par exemple, le fait de diffuser du contenu pour se venger (« revenge porn »), pour « s’amuser » ou dans un but lucratif, et la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel avec intention méchante ou dans un but lucratif.
Bon à savoir
Pour toute information complémentaire et pour les définitions complètes, il est préférable de consulter le Code pénal belge, et plus spécifiquement les articles 417/7 et suivants du Code pénal ainsi que 134 et suivants du nouveau Code pénal.
Consulter le site de la Justice sur les infractions sexuelles Infractions sexuelles | Service public federal Justice (belgium.be)
Les facteurs aggravants
Les facteurs aggravants sont des situations qui alourdissent la gravité d’une infraction et augmentent les peines encourues. Elles tiennent compte du contexte de l'acte, de la vulnérabilité des victimes ou de la violence utilisée. Voici les principaux facteurs aggravants :
- Les actes ayant entraîné la mort
- Les actes accompagnés ou précédés de torture, séquestration ou violence grave
- Les actes commis sous la menace d’une arme ou après l’administration de substances
- Les actes commis sur une personne en situation de vulnérabilité (femme enceinte, personne mineure, en situation de handicap…)
- Les actes commis sur un mineur
- L'inceste, c’est-à-dire tout acte à caractère sexuel (viol, atteinte à l’intégrité sexuelle, voyeurisme, etc) commis par un ou une membre de la famille sur une personne mineure. Par membre de la famille, on entend un parent, une personne alliée ascendante ou descendante jusqu’au 3ème degré, un partenaire, une personne occupant une position similaire au sein de la famille des personnes précitées. L’inceste sur une personne mineure est imprescriptible : cela signifie qu’on peut toujours porter plainte sans limite de temps.
- Les actes sexuels intrafamiliaux non consentis, c’est-à-dire tout acte à caractère sexuel (viol, atteinte à l’intégrité sexuelle, voyeurisme, etc) non consentis au sein de la famille. Par famille, on entend un parent, une personne alliée ascendante ou descendante jusqu’au 3ème degré, un ou une partenaire, une personne qui occupe une position similaire au sein de la famille des personnes précitées.
- Les actes motivés par un mobile discriminatoire : actes sexuels non consentis ciblant une personne pour des raisons touchant à la race, le genre, la religion, la grossesse, le handicap, etc.
- Les actes commis par une personne en position d'autorité ou de confiance.
- Les actes commis avec l’aide ou en présence de plusieurs personnes.
Bon à savoir
Pour toute information complémentaire et pour les définitions complètes, il est préférable de consulter le Code pénal belge, et plus spécifiquement les articles 417/12 du Code pénal et 134 du nouveau Code pénal.
Organismes
Services professionnels
Womando
Espace Chrysalide
Ressources
Outils de référence
Témoignages
Elles et ils témoignent...
Formations